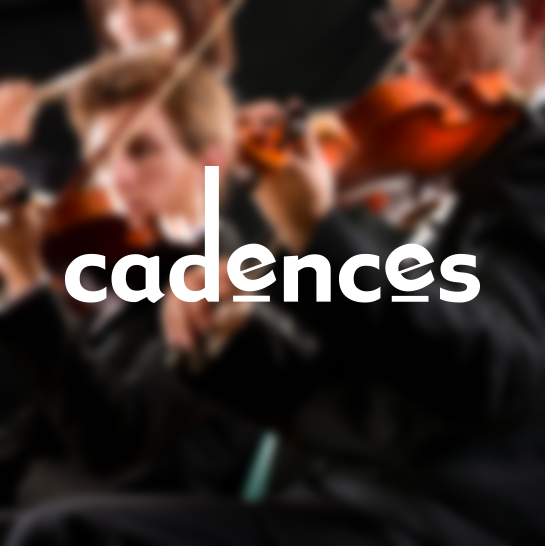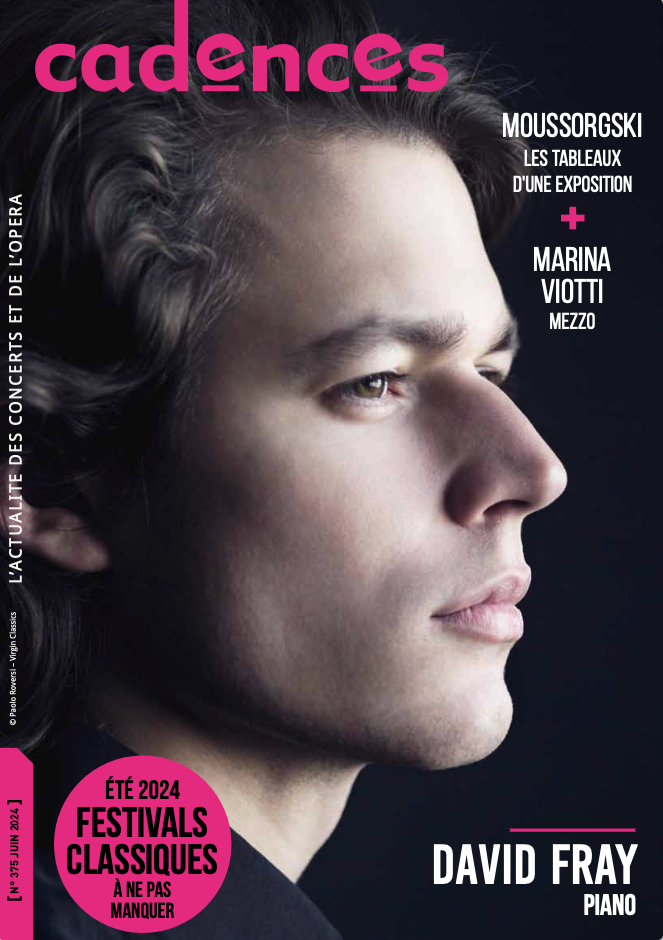Jean Rondeau l'intégrale Louis Couperin
 Partager sur facebook
Partager sur facebook
Figure majeure du clavecin français, Jean Rondeau signe une intégrale Louis Couperin qui est le fruit de plusieurs années d’un travail patient et inspiré. Il en donne une restitution à la Cité de la musique en novembre.
Ces dernières années, quels ont été les temps forts qui vous ont nourri artistiquement ?
En plus de cette intégrale Louis Couperin, qui a pris une place prépondérante dans ma vie musicale ces dernières années, j’ai eu l’opportunité de m’atteler également à des projets créatifs incluant de la musique nouvelle et aussi des façons neuves d’appréhender le clavecin et l’écriture musicale. Ainsi, quelques concerts çà et là ont jalonné mon parcours, et le travail de fond derrière ces projets a été une importante source de réflexion et d’inspiration.
Quelle place occupe le clavecin solo par rapport à la musique de chambre dans votre carrière ?
Tout d’abord, en tant que claveciniste, nous avons le privilège d’avoir un répertoire particulièrement prolifique en solo. De nombreux compositeurs ont écrit pour cet instrument spécifiquement, et leurs œuvres sont souvent vastes. De plus, l’histoire de cet instrument, avec ses innovations de facture constantes, accompagne l’évolution des styles qu’il aborde. Ainsi, entre le XVIᵉ siècle et le XVIIIᵉ siècle, trois siècles viennent nourrir un répertoire immense (sans oublier le répertoire du XXᵉ siècle, qui a une place particulière dans l’histoire de cet instrument revenu progressivement au-devant de la scène, répondant à l’aspect sinueux de son parcours). Et double chance : c’est un instrument phare de la basse continue – cette technique d’accompagnement basée sur l’improvisation, qui se manifeste quand il s’agit de musique de chambre. Il devient difficile de s’ennuyer avec cet instrument ! Pour ma part, j’aime alterner entre la musique de chambre et le solo de manière plus ou moins égale, disons, car l’une et l’autre des approches se complètent et se nourrissent.
Comment est née l’idée d’enregistrer l’intégrale de Louis Couperin ?
J’avais depuis longtemps en tête le projet d’enregistrer du Louis Couperin. Mais, de fil en aiguille, il m’a été compliqué de faire une sélection dans son œuvre. L’œuvre pour orgue est venue compléter celle pour clavecin, la musique de chambre par-dessus ça, et surtout le projet de dresser une fresque musicale de ce style naissant au milieu du XVIIᵉ siècle, en incluant des compositeurs contemporains de Louis Couperin, ainsi que des transcriptions. C’est sans doute le seul compositeur dont j’enregistrerai l’intégrale.
Qu’est-ce qui vous attire dans la musique de Louis Couperin ?
Sa simplicité et sa franchise émotionnelle. Il y a quelque chose de brut et de vrai. L’inventivité harmonique qui parcourt, danse après danse, ces formes traditionnelles et les nombreuses surprises qui en découlent, à chaque coin de notes. L’extraordinaire liberté des préludes non mesurés et ce à quoi ils confrontent l’interprète : redoubler d’effort pour faire comprendre le texte, l’éclaircir ! Les aspects sombre et joyeux qui cohabitent, la douceur, l’intimité…
Comment avez-vous organisé cette intégrale ?
J’ai souhaité ne pas faire l’impasse sur une approche narrative du projet, notamment par sa mise en forme. J’ai tenté de me saisir de cette vaste matière musicale pour l’approcher comme un grand roman, disons. Il y a au total 12 heures de musique réparties sur 10 CDs, dont la limite en temps s’oriente autour de 80 min. Pour ce faire, j’ai pris soin d’organiser les choses par chapitres et paragraphes, à travers la répartition à la fois dans chacun des disques, mais aussi dans la composition des suites. Les suites peuvent être vues comme les épisodes d’une série : on peut en écouter une seule, ou bien passer à la suivante et les enchaîner. J’ai essayé de laisser le plus possible de liberté dans l’appréhension de l’écoute du projet : plusieurs couches différentes se dessinent selon la manière dont on veut l’aborder. Ce qui a été particulièrement moteur, ce sont les couleurs, traduites par les différents sons et notamment par le choix des instruments et la place qu’ils prennent. Avec une forme aussi large, il était important de générer du contraste coloristique. C’est pourquoi j’ai enregistré sur 7 instruments : 5 clavecins et 2 orgues. De nombreuses pièces de musique de chambre viennent aussi prendre un sens dans ce récit et sont comme des événements marquants. Chacun des 10 CDs se conclut par un Tombeau – cette forme musicale qui rend un hommage émotionnel et puissant aux musiciens et compositeurs de l’époque – comme une page que l’on doit tourner.
Quelle place laissez-vous à la spontanéité dans un projet aussi rigoureusement construit ?
La spontanéité se retrouve davantage dans le fond que dans la forme, bien sûr. Le moment de l’enregistrement, cet instant où la matière musicale se forme, où le texte se dit, est venu contrecarrer l’assemblage précis par des élans fulgurants que cette musique m’invitait à suivre. J’ai tenté de répondre aux surprises que j’évoquais, de jouer avec et de me laisser moi-même surprendre par une musique que je connais pourtant si bien. L’idée fut de retrouver une fraîcheur, comme si le texte m’était inconnu et que je le découvrais en temps réel. Pour cela, il m’a été nécessaire d’atteindre un état méditatif, qui me permette de mettre de côté une partie de ma conscience trop connectée au savoir et à l’acquis.
Vous allez jouer sur des instruments du Musée de la musique. Qu’apportent-ils à votre interprétation ?
Les instruments sont toujours la base qui me guide. Je pense qu’il est impossible de plaquer une manière de jouer, ou même des idées préconçues, sur un instrument si l’on souhaite être dans le juste. C’est la façon dont on l’écoute et dont on répond à son expressivité qui permet un alignement équilibré du discours.
Y a-t-il une pièce qui vous touche particulièrement ?
Les préludes non mesurés sont un challenge tout particulier. Évidemment, l’absence de mesure se substitue à une certaine liberté dont le cadre peut laisser l’espace. On doit redoubler d’effort pour clarifier le discours, un peu comme un texte dont on aurait enlevé toute ponctuation, ou même tout espace entre les mots, et que l’on devrait lire à haute voix pour le faire comprendre. Mais ce n’est pas tout. On pourrait penser que la difficulté réside dans ce concept du non-mesuré, mais quand on se penche davantage sur ces œuvres, on réalise à quel point ce sont des improvisations écrites : des flux de cadences ininterrompus, comme un slam improvisé où l’on ne saurait vraiment ce qui va être dit dans les quelques mots à venir. C’est extrêmement déroutant, et pour créer un lien avec l’auditeur, il est nécessaire de clarifier tout ce qui s’y passe et de parvenir à se l’approprier d’une manière toute particulière.