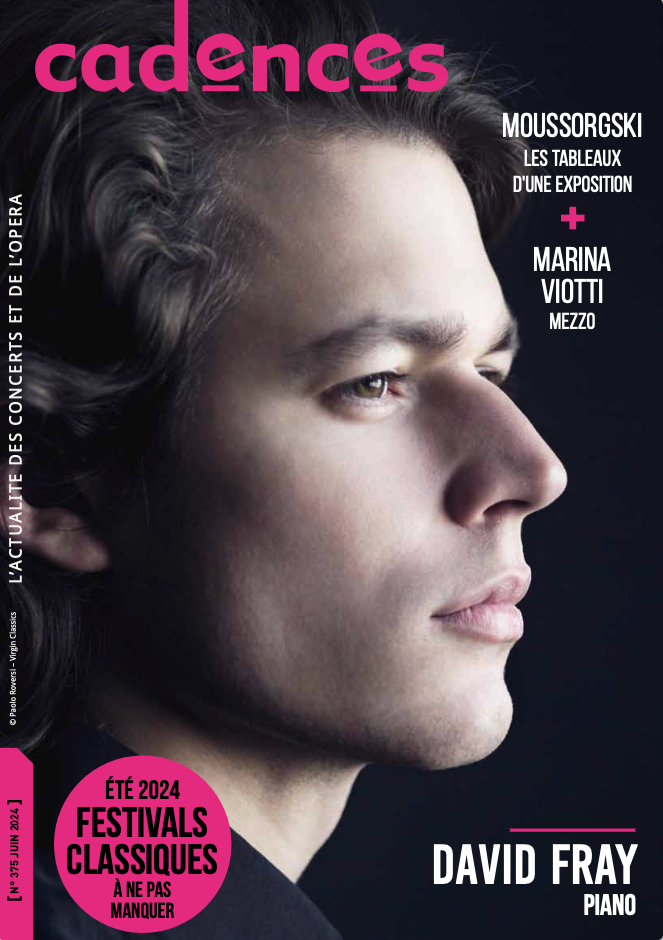Klaus Mäkelä, direction le 18 février, Philharmonie
 Partager sur facebook
Partager sur facebook
Concert explosif en perspective, avec le Petrouchka magnifié par l’Orchestre de Paris et Klaus Mäkelä, fort familiers de cette partition qui permet aux phalanges symphoniques de montrer toutes leurs capacités.
Déjà commanditaire du ballet L’Oiseau de feu créé à l’Opéra de Paris en 1910, le directeur des Ballets russes Serge de Diaghilev est également l’homme qui pousse Stravinski à transformer un projet de concerto pour piano et orchestre en ce qui allait devenir Petrouchka. Il faut dire que le sujet porte une charge chorégraphique évidente, comme le soulignent les célèbres mots du compositeur lui-même (Chroniques de ma vie, 1935) : « un pantin subitement déchaîné qui, par ses cascades d’arpèges diaboliques, exaspère la patience de l’orchestre, lequel, à son tour, lui réplique par des fanfares menaçantes ». Avec une chorégraphie de Fokine et Nijinski en Pantin, sous la direction de Pierre Monteux, la création triomphale au Théâtre du Châtelet le 13 juin 1911 donne raison à Diaghilev. L’œuvre connut plusieurs remaniements, la version de 1947 (celle officiellement publiée) s’imposant progressivement comme la plus souvent donnée.
Les 4 tableaux de Petrouchka jouent sur l’illusion théâtrale : l’on assiste à un spectacle de marionnettes dans lequel les impertinences du « héros » mènent à sa mort, son fantôme faisant in fine une apparition spectaculaire. Redoutable sur le plan rythmique (des superpositions périlleuses), ce ballet grotesque multiplie les images aux couleurs vives, prétexte pour l’orchestre de déployer des sonorités aussi glorieuses que tranchantes. Sans conteste, il prépare la voie aux grands bouleversements et à l’immense scandale du Sacre du Printemps survenant deux ans plus tard.
Il va sans dire que Klaus Mäkelä et l’Orchestre de Paris sont ici à leur affaire, retrouvant une partition incendiaire qu’ils connaissent dans ses moindres grincements (avec le pianiste Nicolaï Maslenko pour le deuxième tableau). En première partie, avec Le Tombeau de Couperin et Ma mère l’Oye de Ravel, ils auront l’occasion de démontrer la beauté de leurs sonorités, ressuscitant une époque bénie de l’histoire musicale parisienne.