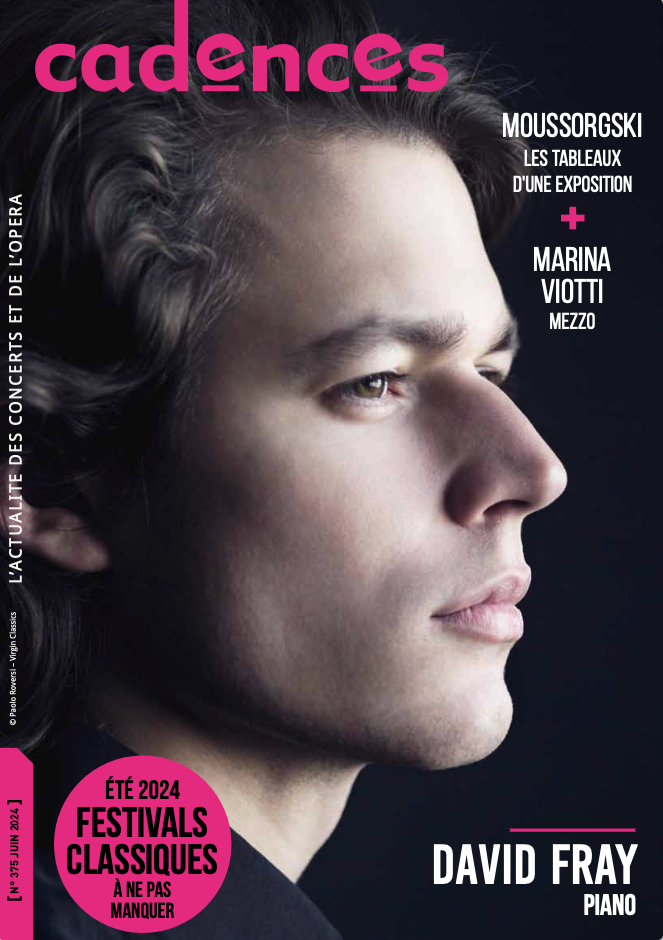Arielle Beck Romantique dans l’âme
 Partager sur facebook
Partager sur facebook
On parle d’elle comme d’un prodige du piano – elle a 16 ans – mais Arielle Beck revendique le statut de musicienne à part entière, récusant le statut de phénomène que lui vaut son âge. Force est de reconnaître qu’il suffit de quelques propos pour confirmer toute la légitimité de cette demande. Rencontre avec une artiste d’exception.
Qu’Arielle Beck nous autorise à « évacuer » d’emblée ce sujet : notre pianiste a maintenant 16 ans, avec déjà une notoriété considérable. Les habitudes journalistiques nous poussent à parler « d’une incroyable maturité pour une artiste si jeune » mais cette formule même l’agace : « On parle de l'âge biologique, mais en même temps, la propre perception de l'âge, parfois, ne colle pas tout à fait avec lui. C'est difficile de dire qu'on se sent avoir 16 ans. Est-ce que, finalement, avoir 16 ans ou avoir 30 ans ou 50 ans, cela change quelque chose ? Pourquoi serait-on plus impressionné parce qu’on entend quelqu'un de jeune ? Je préfère la vision objective consistant à traiter l'art de quelqu'un pour ce qu'il est, dans l'absolu. Pour ma part, je traite mon art pour ce qu’il est, c’est-à-dire dans l’absolu. »
Parlons maintenant de qui l’intéresse avant tout : la musique. Au Théâtre des Champs-Élysées, Arielle Beck aborde la sainte trinité du romantisme allemand, avec Schumann, Schubert et Mendelssohn. La poésie fascinante mais parfois fantasque de Schumann effraie plus d’un pianiste. Nul doute chez elle : « Des trois compositeurs que je vais jouer, je pense être davantage proche de lui que des autres. Schumann me suit depuis mon enfance, car c’est l’un des premiers compositeurs que, petite, j'ai entendu, l'un des premiers que j'ai joués aussi. Je ressens une extrême proximité avec cet univers fantastique qu'il caractérise, un univers qui est peu celui de l’enfance, par ailleurs. Sa musique ne m'a jamais semblé difficile, contrairement à ce que l’on dit souvent. Évidemment, tout n'est pas nécessairement limpide au premier abord. Dans l’approche que je qualifierais d’humaine, il y a des choses un peu plus hermétiques et pour le public, elle peut sembler compliquée. La première sonate est emplie d’idées un peu enchâssées qui peuvent faire perdre le fil, que l’on doit condenser pour en faire une forme. C’est tout le travail de l’interprète que de la rendre plus digeste, dirais-je, plus structurée. »
Schumann, l’amour d’une vie
Arielle Beck n’a nullement peur d’affirmer ses affinités pour un compositeur parfois jugé peu favorable à la vente de billets : « C’est moi qui ai demandé à jouer cette Sonate n° 1, tout comme j’ai demandé à mettre l’Humoresque dans mon premier disque chez Mirare. J’aime beaucoup déchiffrer ce que j’ai dans ma bibliothèque, ce sont mes moments un peu personnels. Quand j’ai ouvert la partition de cette sonate il y a deux ans, il était clair que j’allais la travailler pour la donner en concert la saison d’après Je l'ai tout de suite tellement aimée que je n'ai pas ressenti certaines problématiques. Quand j'aime une œuvre de façon assez obsessionnelle, j’ai tendance en général à passer à côté de certaines difficultés. Je les ressens bien évidemment, mais elles passent derrière mon enthousiasme. J'étais tellement passionnée par l'écriture que je ressentais simplement le pur plaisir de la jouer, de la travailler, de l'entendre tous les jours. C'était la seule chose qui comptait pour moi. »
Franz Schubert soulève chez elle la même soif d’exploration : « Par exemple, il y a encore quelques jours, je travaillais la Sonate n° 14 de Schubert et j’ai été fascinée de voir à quel point on peut donner à un accord un sentiment différent en fonction de la manière dont on timbre les aigus ou les graves. La musique de Schubert offre la possibilité de mener de véritables expérimentations sur les accords, les sonorités, pour les sentiments aussi. Dans ce domaine, il est vraiment merveilleux. Dans le premier mouvement de sa sonate, je pense vraiment à une allégorie de la mort mais, soudainement, surgit toute la lumière de ce thème en la majeur, qui est irréelle, inhumaine, surhumaine même. C’est vraiment une musique très spéciale, très à part. Du point de vue compositionnel, elle paraît simple mais cette simplicité est précisément difficile à traiter. Il faut la restituer sans qu'elle tombe vers une sorte de monotonie et sans qu'elle tombe vers une complexité qui la rendrait un peu sirupeuse. »
Romantique et baroque
Felix Mendelssohn souffre, on le sait, d’une réputation quelque peu absurde : sa vie réputée sans nuage nous vaudrait une musique tout aussi diaphane, trop limpide (et de ce fait, « facile »). Il faut nuancer ce jugement : « Je dois avouer que, plus jeune – ou encore plus jeune que maintenant –, je n’aimais pas trop Mendelssohn, sa musique ne m’intéressait pas. Il y a peut-être plus d’œuvres moins intéressantes que chez Schumann ou Schubert. Mais il se trouve que pour la saison prochaine, je dois réfléchir à un certain concept de concert qui m’a conduite à me pencher un peu plus sur l’œuvre pianistique de Mendelssohn. On pense souvent aux romances sans parole qui sont très belles mais un peu inégales. Or, il y a aussi les préludes et fugues, qui ne sont pas que des pages inspirées par Bach. Celui en mi mineur montre une très grande maîtrise, un grand savoir du contrepoint. On entend énormément cet aspect dans les Variations sérieuses. C’est passionnant de voir ce qui fait qu’une fugue est romantique, qu’elle n’est plus baroque. »
Prenons ici un petit chemin de traverse pour évoquer la musique baroque : « Cela faisait longtemps que je n’avais pas fait de musique baroque mais en ce moment, je joue en concert la Suite anglaise n° 2 de Bach. Elle me procure tellement de plaisir. J’aime ce répertoire et malheureusement je n’en joue pas assez actuellement. Je me souviens de mon tout premier récital dans lequel je faisais des œuvres de Couperin et Rameau. J’adore déchiffrer Scarlatti, Händel ou même les fils Bach. Récemment, on m’a parlé de Johann Kuhnau et j’aimerais beaucoup explorer son œuvre. »
Retour au concert du Théâtre des Champs-Élysées et à Mendelssohn : « Sa musique contient tout de même des moments de tourment extrême. Je ne sais pas si le sentiment du tragique est lié nécessairement à la vie. Il se trouve que dans l’histoire de la musique, beaucoup de compositeurs ont eu une vie tragique, mais je ne crois pas qu’il faille avoir connu une vie tragique pour écrire une œuvre tragique. Parfois, on peut écrire une œuvre lumineuse alors qu’on vient de vivre une grande tragédie. Moi-même je compose une musique parfois un peu déprimante, assez sombre, alors que j’ai une vie tout sauf sombre et déprimante. »
Car Arielle Beck est également une compositrice dont on peut attendre, très certainement, des joyaux à venir. Mais nous n’ouvrirons pas, ici, un chapitre qui demanderait un article à part entière. Goûtons pour le moment les alchimies sonores et les discours expressifs d’une pianiste hors norme.
Yutha Tep - publié le 01/10/25