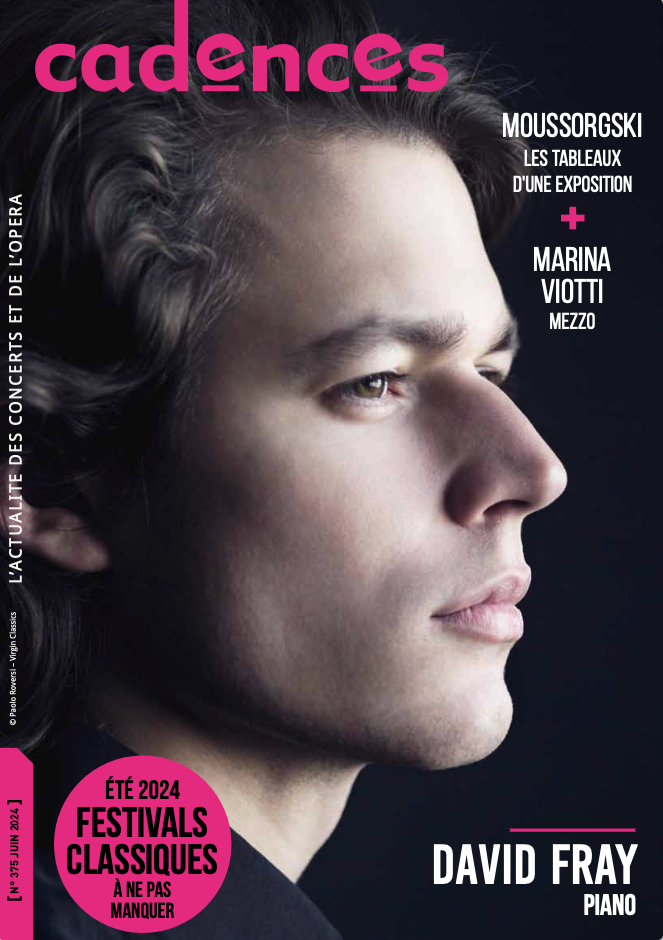Mozart Les Noces de Figaro
 Partager sur facebook
Partager sur facebook
La Trilogie Da Ponte voit Mozart parvenir au sommet de son art unique et au sein de cette illustre triade, Le Nozze di Figaro s'impose comme l'élément le plus parfait dans son imbrication extraordinaire de la musique et du texte, avec une intrigue qui ne faiblit jamais.
Dans ses Mémoires, Lorenzo da Ponte s’attribua, avec une certaine complaisance mais non sans une certaine légitimité, un rôle prépondérant dans la genèse des Nozze di Figaro mais lui-même reconnut que l’idée de mettre en musique la pièce de Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais émana de Mozart. L’entreprise s’avérait certes audacieuse : avec sa critique au vitriol des privilèges archaïques d’une aristocratie tournée vers elle-même, La Folle Journée ou Le Mariage de Figaro connut un succès public immense lors de sa création en 1784 dans le Théâtre François, actuel Théâtre de L’Odéon, mais s’attira, naturellement, les foudres des autorités de l’époque, les gouvernements tentant en vain de juguler un engouement à l’échelle du continent, avec une multiplication de traductions dans les différentes langues. Mozart lui-même en avait une dans sa bibliothèque. À Vienne, l’empereur Joseph II, pourtant souverain éclairé et mécène des arts, mais frère de la reine de France Marie-Antoinette, ne pouvait accepter officiellement une œuvre si contestée en France et interdit en 1785 la représentation de la pièce dans la capitale de l’Empire austro-hongrois.
Le célèbre monologue de Figaro (Acte IV, scène 3) enragea la noblesse avec son ressentiment hargneux pré-révolutionnaire que partageait une très large majorité de la population : « Noblesse, fortune, un rang : tout cela rend si fier ! Qu’avez-vous fait pour tant de biens ? Vous vous êtes donné la peine de naître, et rien de plus ». On comprend aisément l’écho que cette tirade pouvait faire naître dans l’esprit d’un musicien longtemps malmené par le Prince-archevêque Colloredo à Salzbourg. L’esprit progressiste et la passion pour la musique du prélat ne l’empêcha nullement de se montrer tyrannique vis-à-vis de Mozart dont le caractère difficile et l’apparente insolence, il est vrai, devaient hautement l’irriter. Mozart fit la rencontre de Lorenzo da Ponte chez l’un de ses protecteurs, le baron Wetzlar. Installé à Vienne depuis 1781 et nommé par l’empereur pour succéder au grand Métastase comme poète de la cour, da Ponte avait déjà écrit plusieurs livrets, notamment pour Antonio Salieri celui d’Il ricco d’un giorno (Le riche d’un jour) créé en 1784. Malgré les doutes que Mozart exprima dans une lettre à son père sur la sincérité de son futur librettiste, Da Ponte tint parole en se lançant avec le compositeur dans une adaptation de la pièce de Beaumarchais. Il eut la délicate tâche de convaincre Joseph II d’autoriser la création des Nozze di Figaro, présentant au monarque des extraits que ce dernier, au goût musical très sûr, approuva pleinement.
Un triomphe mais…
Moyennant la suppression des éléments les plus sulfureux de la pièce de Beaumarchais, Joseph II donna son assentiment, ce qui permit aux deux hommes de lancer l’achèvement de la partition et les préparations des répétitions. Une autre thèse, que l’on doit à Niemetschek, le premier biographe de Mozart, affirme que l’Empereur lui-même, sensible malgré tout aux qualités de la pièce de Beaumarchais, fut à l’origine de la commande.
Contrairement à ce qu’affirma Da Ponte dans ses mémoires, la partition ne fut sans doute pas écrite en six semaines : Mozart connaissait une activité soutenue, contraint de répondre à une commande, le singspiel Der Schauspieldirektor K. 486 (Le Directeur de théâtre) créé le 7 février 1786, tout en composant ses magnifiques Concertos pour piano n° 23 K. 488 et n° 24 K.491. Mozart avait d’autant plus de raison d’y mettre toute sa science que Le Nozze di Figaro était le premier grand opéra en italien qu’il allait créer à Vienne-même. À cette date, il avait déjà à son actif des ouvrages aussi aboutis qu’Idomeneo ou L’Enlèvement au sérail. Signe de l’importance qu’il accordait à sa création, la partition des Nozze contenait un nombre inusité d’indications à destination des chanteurs (ce qui ne fut pas le cas des deux autres opéras de la Trilogie).
La préparation des représentations fut tout sauf une sinécure car le comte Rosenberg, intendant des théâtres impériaux qui n’appréciait guère Mozart (« une musique trop difficile pour le chant », ne cessait-il de clamer), se montra assez difficile, pressant régulièrement le compositeur de livrer sa musique au plus vite. Néanmoins, les répétitions se déroulèrent avec suffisamment d’efficacité pour que la création eût lieu le 1er mai 1786 au Burgtheater. Le triomphe fut éclatant et l’on ne comprend guère que Le Nozze di Figaro soit retiré de l’affiche après seulement 9 soirées. Peu importe : l’opéra effectua le voyage jusqu’à Prague où il rencontra un engouement indescriptible et entama sa marche vers l’immortalité.
Même atténué en regard de la pièce de Beaumarchais, le livret de Da Ponte ne se livre pas moins à une critique acerbe des pesanteurs sociales causées par les privilèges de l’aristocratie. L’intrigue de La Folle Journée est conservée : alors que Susanna et Figaro s’apprêtent à s’épouser, le comte Almaviva compte fermement imposer son « droit de cuissage », au grand désespoir de sa femme, la Comtesse, que l’indifférence et les mœurs volages de son mari plongent dans une profonde mélancolie. Après moult rebondissements, après les intrigues de la vieille Marcellina et du vieux barbon Bartolo ou les caprices de Cherubino, adolescent déjà coureur de jupons aussi inconséquent qu’attendrissant, Susanna et Figaro parviennent à piéger le comte. Pris la main dans le sac par la Comtesse, Almaviva se repent et promet sa fidélité à son épouse.
Un orchestre démiurge
Pas de grand monologue de Figaro comme dans la pièce française mais le « Se vuol ballare » chanté par Figaro au début de l’opéra se montre d’une ironie peu respectueuse envers un comte qui se révélera, effectivement, un personnage peu amène. La contestation de l’ordre sociale ne concerne pas que les privilèges de la noblesse : plus que Figaro, qui a beau fanfaronner (« Non più andrai, farfallone amoroso »), Susanna s’affirme comme la pièce maitresse sur le plan théâtral, laissant à la comtesse la première place dans le domaine émotionnel. Même l’acariâtre Marcellina joue un rôle-moteur dans les rouages des machinations qui se superposent les unes sur les autres. L’amour de Mozart pour les voix féminines s’affirme une fois de plus et les pages les plus touchantes sont bien « Deh vieni, non tardar » de Susanna et, bien sûr, le sublime « Dove sono i bei momenti » de la comtesse, sans oublier le bref mais si attendrissant « L'ho perduta » de la petite Barbarina. Avec « Non so più » et surtout « Voi che sapete », Cherubino hérite de deux « tubes » illustrant merveilleusement les mouvements intérieurs d’une jeunesse qui ne s’est pas encore trouvée affectivement. C’est finalement le Comte qui, dans le domaine des airs, doit se contenter de la portion congrue, comme si son manque initial d’empathie émotionnelle ne pouvait s’accommoder de la magie du chant. Suprême raffinement, Mozart tourne le dos résolument au chant orné, qui n’aurait guère eu de sens dans cette œuvre critiquant l’ordre ancien et qui fera son retour dans les deux autres volets de la Trilogie, certes dans une perspective bien définie. Cette sincérité de l’écriture vocale fait tout le prix des Nozze di Figaro et permet au compositeur de faire avancer l’intrigue tambour battant.
Contemporain de deux sublimes concertos pour piano, l’opéra ne serait pas ce qu’il est sans cet orchestre démiurge, peut-être le plus accompli des trois Da Ponte. Tour à tour vif-argent (l’Ouverture devenue célèbre), narquois dans les airs de Figaro, plein de morgue aux côtés du Comte, d’une douceur infinie dans l’air de Susanna ou celui de la Comtesse, hilare quand il commente le chant de Cherubino, l’orchestre mozartien se déploie en majesté, avec cette alchimie sonore que le « Divin Amadeus » est seul capable.
Le Nozze di Figaro, officiellement affiché comme un opera buffa, une comédie, contient mille éléments au fond sérieux, teintés de nostalgie, voire d’une tristesse, qui peuvent sans doute être liées aux souvenirs douloureux des épreuves du passé. Par son humour doux-amer, la parfaite fusion entre texte et musique (peut-être la plus évidente de l’histoire), le chef-d’œuvre de Mozart mérite pleinement la place qu’il occupe dans le panthéon lyrique.
Yutha Tep - publié le 01/11/25